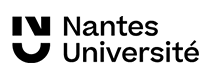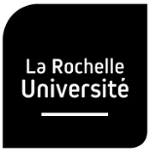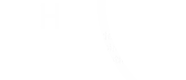- Recherche
Séminaire N°1 "Penser la paix"
-
Le 21 octobre 2025 de 17:00 à 20:00false false
-
Château du Tertre
Campus Tertre
Dans le cadre du programme de recherche de l’Axe SHS du Pôle Humanité de Nantes Université “Faire société : identité(s) en question”, Jenny RAFLIK, professeure d’Histoire contemporaine à Nantes Université (CRHIA) coordonne le premier séminaire intitulé “Penser la paix”.
Intervenantes :
- Dominique Peyrache-Leborgne, LAMO : Récits de guerre, récits de paix
- Stéphanie Morandeau, DCS : Paix et positivisme
Programme de recherche “L’Europe entre guerres et paix”
1. Objectifs scientifiques et résultats attendus
La paix est aujourd’hui un des objectifs fondamentaux de l’Union européenne, au point d’être devenue une part entière de son identité et un moteur de l’adhésion des peuples au projet européen, leur permettant de faire société et de développer des projets communs.
L’importance de la paix dans le projet européen repose sur une façon spécifique de penser la paix en Europe, marquée par de nombreux jalons temporels et philosophiques de la « paix de Dieu » médiévale à la « facilité européenne pour la paix » (2021-2027), en passant par la paix de Westphalie, le « concert européen », les philosophies positivistes, la paix par le droit, la paix positive (Johan Galtung), etc. La paix est un élément essentiel du maintien du bien-être individuel et collectif des Européens, qui ne doit pas seulement être vu en termes de santé ou de bonheur, mais aussi comme une approche globale de la sécurité aux niveaux individuel, local, national, européen et mondial visant à faciliter l’épanouissement humain et sa conservation.
Par cet héritage, l’Union européenne est fille de la Paix. Mais elle en est également mère, puisque depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la construction européenne a pour objectif central la paix et la réconciliation entre les nations européennes. Ce projet, d’abord limité à l’Europe occidentale, s’est élargi face au besoin de consolider une paix durable en Europe après la réunification allemande et la chute du Mur. La promotion de la paix et de la sécurité sur tout le continent et dans le monde est en effet devenue l’un des principes de ses actions extérieures. D’où une identité européenne de sécurité fondée sur la promotion de la paix. Cette identité, l’Europe a cherché à l’exporter, et les ambitions européennes de la paix sont aussi à lire dans les relations entre les Européens et le monde. Là aussi, de nombreux jalons temporels sont à prendre en compte : l’Europe des Lumières nous a légué l’idée d’une paix d’une paix universelle par les échanges et la libre circulation, qui a inspiré les débuts de la construction européenne (CECA, puis traité de Rome). Les philosophies positivistes du XIXe siècle ont ambitionné une paix comme mission civilisatrice par-delà l’Europe, qui pèsent aujourd’hui dans les relations entre les Européens et les pays issus de la colonisation. A l’heure où les forces armées françaises sont contraintes d’évacuer l’Afrique, où elles agissaient souvent dans le cadre de missions européennes, il importe d’en dresser un bilan.
Pourtant, la Paix n’est jamais acquise. Au moment où le monde espérait « la fin de l’histoire » (Fukuyama, 1992), la guerre dans les Balkans mettait au défi les capacités sécuritaires de l’Union européenne. Le retour de la guerre de haute intensité sur le continent depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022 démontre les difficultés de l’UE à s’insérer dans la gestion des grandes crises internationales et à défendre la paix sur le continent. L’Union européenne est toujours à la recherche de sa souveraineté, d’une crédibilité et d’une force dissuasive dans un système international instable et conflictuel. Au sein même de ses frontières, la paix comme garantie première d’un vivre-ensemble européen est fragilisée par les conséquences sociales de la mondialisation, la montée des nationalismes, la remise en cause de l’état de droit, le défi migratoire, les crises environnementales, les nouvelles menaces extérieures et les nouvelles formes de conflictualité.
Dans ce contexte, comment la paix peut-elle toujours être préservée comme une valeur fondamentale sur laquelle repose l’Union pour « faire société » ? Les objectifs scientifiques sont de s’interroger sur la préservation de la paix comme valeur fondamentale sur laquelle repose l’Union Européenne pour faire société. En effet, existe-t-il une véritable culture commune de la paix en Europe ? Comment les Européens peuvent-ils être des acteurs et des promoteurs de la paix dans le monde ? Le concept de la paix interroge les fondements du projet européen, l’avenir du processus d’intégration politique -encore partiel- et des sociétés européennes dans leur ensemble, mais aussi les politiques menées par l’Union européenne, à l’intérieur comme à l’extérieur du continent. Ainsi, ce projet aura pour impact d’asseoir la visibilité de Nantes Université dans les études sur la guerre et sur la paix, et, de développer les études européennes au niveau national et international.
2. Description du consortium
Coordination scientifique : Jenny Raflik, Professeur d’histoire contemporaine, CRHIA, pôle Humanités
Le projet réunira des chercheurs de plusieurs disciplines : histoire, civilisations, droit, science politique et sociologie, géographie, littérature, issus de plusieurs laboratoires et de plusieurs pôles. Le projet s’inscrira dans la continuité du Centre d’excellence Jean Monnet Unipaix, mais en élargira les frontières à d’autres chercheurs.
- CRHIA : Jenny Raflik, Michel Catala, Céline Pauthier, Fabrice Jesné, Frédéric Gloriant, Noam Drif, Mathilde Petiteau, Virginie Chaillou-Atrou, Eric Lechevalier
- DCS : Arnauld Leclerc, Carole Billet, Lauren Blatière, Stéphanie Morandeau, Alycia Durlot
- CRINI : Karine Durin, Charlotte Barcat, Maiwenn Roudaut, Henning Fauser, Jorge Cagiao Conde et Grégory Permet
- CENS : Sylvain Dufraisse, Estelle d’Halluin
- LAMO : Dominique Peyrache-Leborgne
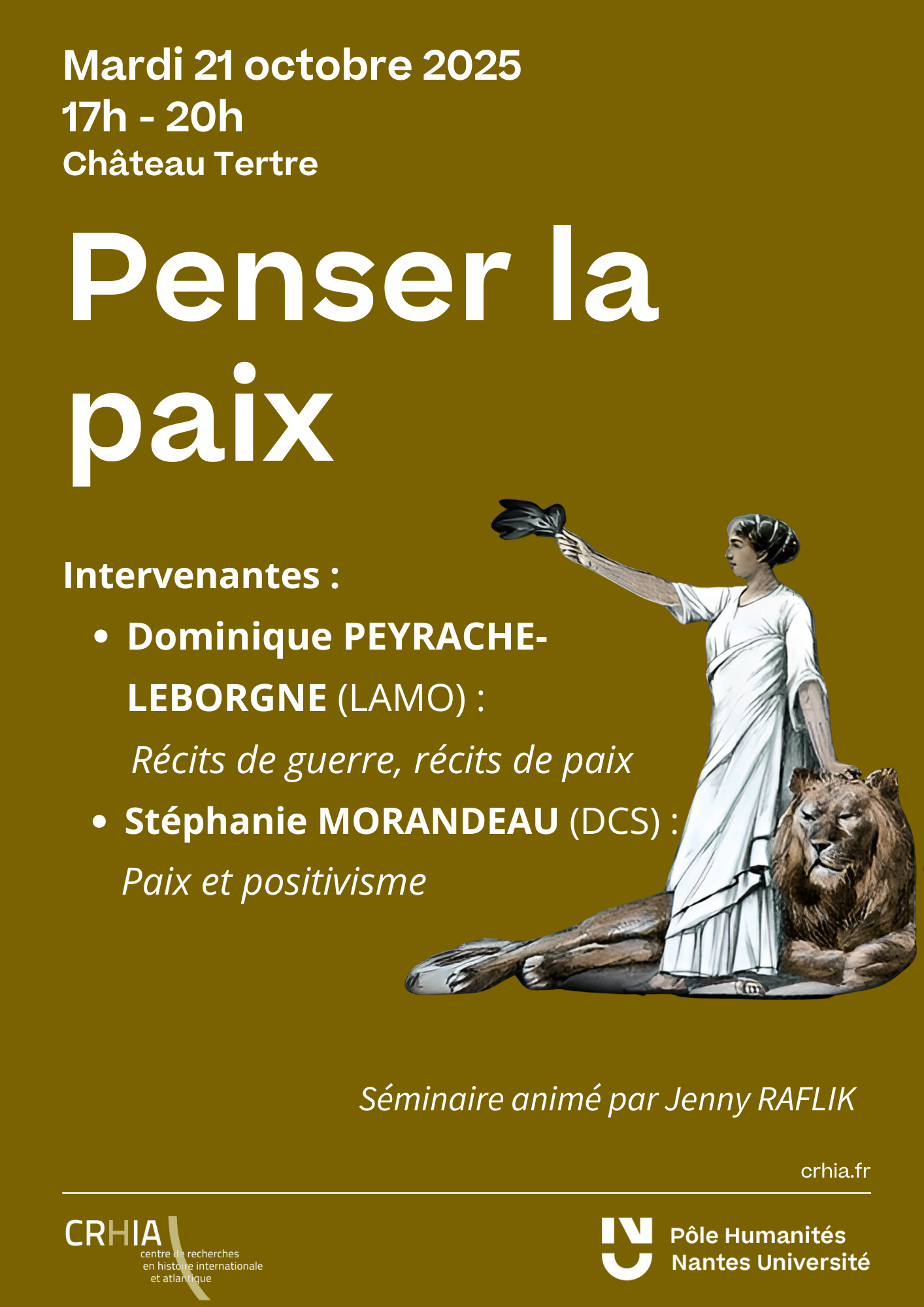
Mis à jour le 29 septembre 2025.